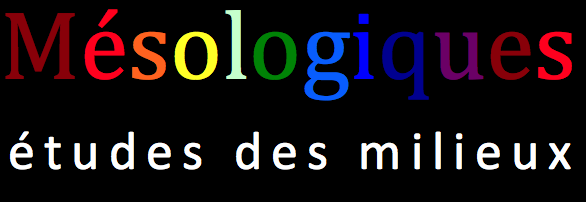|
| Mt. Ktaadn, Frederic Edwin Churck (1853) (Yale University Art Gallery) |
Colloque La naturalité en mouvement : environnement et usages récréatifs de la nature. Domaine Olivier de Serres, Le Pradel, 20-22 mars 2013
Natura natura semper
(la nature sera toujours à naître)
– un point de vue mésologique –
par Augustin Berque
§ 1. Depuis quand « la nature » existe-t-elle ?
La nature, en principe, existe depuis que le monde existe. La tradition chrétienne nous a laissé penser que celui-ci fut créé par un être absolu, Dieu, à un certain moment. Quand cela ? Selon les calculs effectués en 1654 sur la base des Écritures par John Lightfoot, vice-chancelier de l’Université de Cambridge, ce fut le septième jour, le 26 octobre 4004 avant Jésus-Christ à neuf heures du matin, que Dieu couronna la Création en créant l’Homme ; après quoi, il se reposa[1]. La nature existerait donc depuis une semaine avant cette date. La science moderne, après de durs combats contre l’Église, a reculé celle-ci de 13,7 milliards d’années, plus ou moins 700 millions ; mais cela ne change pas le principe : la nature existe depuis qu’existe l’univers. C’est l’idée commune à la science et à l’opinion ordinaire.
Puis des iconoclastes, influencés par la phénoménologie, ont fait remarquer que la notion de nature n’existe pas depuis toujours, ni partout sur la Terre. Elle serait historique, plutôt que naturelle. En Grèce par exemple, elle remonte aux Présocratiques, aux environs du VIe siècle av. J.-C.. Ces premiers philosophes utilisèrent pour cela le mot phusis. Ils ne l’ont pas inventé, car sa première apparition, du reste un hapax, a été relevée dans l’Odyssée. Le hic, toutefois, c’est que ce hapax n’a pas encore le sens de « nature », mais de « ce qu’est une certaine plante » :
Hôs ara phônêsas pore pharmakon Argeiphontês
|
Ayant ainsi parlé, le dieu aux rayons clairs
|
Ek gaiês erusas, kai moi phusin autou edeixe.
|
tirait du sol une herbe, qu’avant de me donner, il m’apprit à connaître.
|
Rhizê men melan eske, galakti de eikelon anthos
|
La racine en est noire, et la fleur, blanc de lait.
|
Môlu de min kaleousi theoi, chalepon de t’orussein
|
Les dieux l’appellent môlu. Il est difficile de la déraciner
|
Andrasi ge thnêtoisi ; theoi de panta dunantai.
|
Aux mortels humains ; mais les dieux peuvent tout[2].
|
Et c’est ainsi, parce qu’Hermès lui avait « montré ce qu’était » (phusin…edeixe) cette plante médicinale (pharmakon), qu’Ulysse put échapper au charme versé par Circé, qui l’eût transformé en porc comme ses compagnons. Le pouvoir de cette plante est ambivalent, commente-t-on aujourd’hui[3] : comme pharmakon, elle a les deux sens de « poison » et de « remède » ; et elle est blanche par la fleur, comme elle est noire par la racine. Comment la dire ? Seuls les dieux connaissent son nom, môlu, et seuls ou presque ils peuvent la tirer du sol.
§ 2. Qu’était-ce donc que la phusis ?
On a beaucoup écrit – Heidegger notamment – sur le sens originaire de phusis, mais ce n’est pas le lieu d’entrer dans cette longue histoire. Rappelons simplement son étymologie. Phusis, par le verbe phuein (croître, pousser), descend de la racine indo-européenne bheu-, qui signifie aussi croître, mais également être. C’est par exemple de cette racine que descendent l’anglais (to) be, le français (je) fus, l’allemand (ich) bin (je suis), etc. Mais avant l’être de quelque chose, phusis évoque d’abord la poussée du végétal, phuton (d’où en français l’élément –phyte, comme dans épiphyte, phytoplancton, etc.) ; d’où par la suite l’idée de devenir, de s’accomplir, comme la nature en tant qu’elle réalise son être propre : « la nature »[4].
À cette histoire de vingt-cinq siècles de « la nature », j’ajouterai seulement une petite pierre du point de vue de la mésologie – cette branche du savoir qui étudie les milieux comme relation des sociétés humaines à la nature, et de la nature à elle-même. Pourquoi donc l’« être propre » de cet « elle-même » ? Sans doute pour cette même raison qu’en Chine (où l’on inventa la notion de nature vers le même temps qu’en Ionie), le nom qui lui a été donné le plus généralement, mais plus particulièrement par les taoïstes, c’est ziran 自然 : « de soi-même (zi 自) ainsi (ran 然) ».
La mésologie, donc, s’attache à ladite relation ; ce qui entraîne une parenté avec la géographie, mais aussi avec la phénoménologie herméneutique, donc à l’ontologie ; car cette relation n’a de sens que pour un être quelconque, lequel est loin de se limiter au sujet individuel moderne, celui qu’emblématise le cogito cartésien. La mésologie tient compte en effet que, pout tout être vivant, son milieu a du sens. « Pour tout être vivant », c’est-à-dire pour la nature elle-même. Le problème, c’est évidemment d’accéder à ce sens. Peut-être est-il, en fin de compte, hors de notre portée ? C’est, par exemple, ce que peut laisser à penser le taoïsme, quand Laozi écrit : « L’Humain se règle sur la Terre, la Terre se règle sur le Ciel, le Ciel se règle sur le Dao, le Dao se règle de lui-même » (Ren fa Di, Di fa Tian, Tian fa Dao, Dao fa ziran 人法地、地法天、天法道、道法自然)[5]. Le Dao ne se règle sur rien d’autre que lui-même, de soi-même ainsi ; et c’est ce « de soi-même ainsi » qui, petit à petit, a pris le sens de « nature ». Comment le saisir, alors ? Autrement dit, comment saisir le sens de la nature ?
Revenons à Homère. L’Odyssée nous dit que le dieu qui aide Ulysse est Hermès, l’Argeiphontês. Cette épithète est obscure. Elle est populairement interprétée comme « le meurtrier d’Argos » (le géant aux cent yeux, qu’Hermès tua pour délivrer Io) ; mais Victor Bérard a ici choisi une autre des interprétations possibles : « (le dieu) aux rayons clairs », ce qui est effectivement une des épithètes d’Hermès, mais quelquefois aussi d’Apollon. En l’occurrence, les rayons clairs conviennent à ce que fait ici Hermès, à savoir éclairer Ulysse. Il l’éclaire en tirant de la terre une plante merveilleuse, dont il lui enseigne les pouvoirs.
Mais pourquoi donc Hermès, puisque l’Argeiphontês pourrait aussi être Apollon ? Parce que la scène s’accorde à ce qu’il représente : c’est le dieu aux pouvoirs magiques, « le dieu de l’hermétisme et de l’herméneutique, du mystère et de l’art de le déchiffrer »[6]. Son caducée, en particulier, avec les deux serpents dont l’un monte et l’autre descend, symbolise l’équilibre des contraires, ce que l’on retrouve ici dans le pharmakon (soit remède, soit poison) et dans le môlu, plante à la fois blanche et noire. Bien renseigné, Ulysse bénéficiera de son côté positif ; ce qui, au lieu d’être transformé en cochon, lui vaudra l’amour de Circé.
Tous ces symboles nous laissent un large éventail d’interprétations possibles. J’en tirerai celle-ci :
Hermès étant le Lug celtique[7], le dieu polytechnicien, son intelligence industrieuse est capable de « tirer de la terre » (orussein) certaines ressources. À partir de la terre, autrement dit de la nature brute, une certaine relation fait accéder quelque chose à l’existence. Ce quelque chose, c’est ici la phusis d’une plante sauvage, qui accède à l’intelligence humaine, laquelle justement la fait exister en tant que quelque chose : un remède.
Cet « exister en tant que » nous laisse entrevoir l’essence de la relation mésologique. J’y reviendrai un peu plus loin ; mais auparavant, exploitons un peu plus cette plante bizarre que les dieux appellent môlu.
§ 3. Le principe de la grotte de Pan
Le môlu a généralement été interprété comme une sorte d’ail. Dans l’édition 2002 de l’Odyssée (op. cit.), annotée par Sylvia Milanezi, celle-ci précise que « Selon Théophraste, Histoire des plantes, IX, 15, 7, le môlu, que l’on utilisait à son époque comme contrepoison et dans les opérations magiques, poussait autour de Phénée et de Cyllène »[8]. Où sont Phénée et Cyllène ? En Arcadie. Or l’Arcadie, c’est cette région du Péloponèse que notre histoire associe à l’idée de nature, parce que c’est là qu’est né le culte de Pan, dont le monde gréco-romain a fait la plus grande divinité de la nature[9].
Pan, le dieu aux pieds de chèvre, était en effet d’origine arcadienne ; ce que corrobore cet autre nom de l’Arcadie : Pania, « Terre de Pan », comme le fait que ce soit dans cette région reculée du Péloponèse que l’on a retrouvé les traces les plus anciennes de son culte[10]. Avant de symboliser la nature pour l’ensemble du monde gréco-romain, il fut ici pendant longtemps un simple dieu des pasteurs, protecteur des troupeaux. Comment s’est opéré son changement de statut ? Et d’abord, qu’était-ce que l’Arcadie ?
Pays montagneux, d’accès difficile, l’Arcadie constituait un véritable conservatoire d’archaïsmes politiques, linguistiques et religieux. On y parlait, à l’époque classique, le dialecte le plus proche du grec mycénien et l’on y vénérait, à côté de Pan, d’étranges divinités aux noms parfois secrets, à l’aspect thériomorphe (…). Tout à la fois chasseur et protecteur du gibier, chevrier et fécondateur des petits troupeaux, Pan semble avoir eu, dans ce pays à économie essentiellement pastorale, et où la chasse n’était pas reléguée au statut d’un sport, une fonction proche de celle d’un Maître des animaux, figure bien connue chez les peuples chasseurs et proto-éleveurs. (…). L’Arcadie des poètes, l’Arcadie heureuse, libre, caressée du zéphyr et traversée par les chants amoureux des chevriers, est une invention romaine solidaire d’une rêverie sur le thème des origines de Rome. Le paysage bucolique de Virgile, situé en Arcadie, est un décor. (…) [Théocrite et Callimaque] restent fidèles à une autre tradition, grecque celle-ci, pour laquelle l’Arcadie, loin d’être un lieu idyllique, est une terre aride et inhospitalière, qui abrite une population rude, primitive, quasi sauvage, et chez qui la musique a pour fonction, d’abord, d’adoucir les moeurs[11].
Lieu idyllique ou terre inhospitalière, l’Arcadie fixe en son espace agreste le temps primordial des plus lointaines origines : antérieurs à la lune, ses habitants ne se nourrissent-ils pas des glands de leurs chênes, ces chênes ancestraux dont ils seraient nés ? C’est du moins ce qui se dit, dans l’imaginaire grec où l’Arcadie incarne la régression toujours possible vers les temps originels de la sauvagerie[12].
Or en 490 avant Jésus-Christ[13], quelques jours avant la bataille de Marathon, selon Hérodote, le héraut Philippidès[14], au sortir de Tégée (en Arcadie), est hélé par le dieu Pan. Celui-ci lui promet d’assister les Athéniens dans leur lutte contre les Perses. Effectivement, Pan sèmera la panique dans les rangs des Mèdes, assurant la victoire grecque. Sur le champ, Miltiade l’en remerciera par une offrande ; mais surtout, les Athéniens marqueront leur reconnaissance en instituant le culte de Pan dans leur cité même. Ils l’installeront dans une grotte au flanc nord-ouest de l’Acropole, au-dessous des Propylées[15]. Les autres cités grecques imiteront Athènes ; et assez rapidement, le culte de Pan se répandra dans tout le monde hellène.
Fait curieux, les Arcadiens quant à eux consacraient à Pan des temples construits, tout comme aux autres dieux. Ce n’est qu’à Athènes, et à son instar dans les autres cités non arcadiennes, que Pan sera logé dans une grotte. Borgeaud remarque à ce sujet que « Rattachée à Pan, la grotte a donc dans le reste de l’Hellade une fonction symbolique particulière ; (…) hors d’Arcadie on doit admettre que la grotte, comme habitat propre de Pan, signifie l’Arcadie même ». Et le commentant, Nicole Loraux précise :
Inséparable du paysage montagneux de l’Arcadie est Pan, et c’est pourquoi, une fois naturalisé Athénien, il se voit attribuer un emplacement de nature sauvage au sein même de la ville : (…) dans une grotte [… alors que] les Arcadiens, eux, ne lui consacrent jamais que des temples en bonne et due forme. [… En effet] en Arcadie une grotte est une grotte, mais hors d’Arcadie la grotte abrite Pan, parce qu’elle « signifie l’Arcadie »[16].
Tout en m’appuyant sur cette interprétation, je la poursuivrai dans un sens mésologique en remarquant ceci : dans son principe, l’installation de Pan dans une grotte au pied de l’Acropole revient à instaurer l’érème (l’espace sauvage) au foyer de l’écoumène (l’espace humanisé). Il ne s’agit pas de la transposition pure et simple, au milieu de la ville, d’un en-soi qui serait étranger à la ville ; car il n’y a pas d’érème en soi, mais en fonction seulement de l’écoumène. Autrement dit, la grotte de Pan est athénienne. Loin d’être purement sauvage, elle est issue de l’atticisme le plus raffiné de la culture grecque.
Mais ce n’est pas tout (car si ce n’était que cela, on en resterait au simple constat que ladite grotte est effectivement localisée à Athènes) : avec cette grotte, Pan change de statut et d’appartenance. Il n’est plus seulement le chèvre-pied, dieu des pâtres arcadiens ; il se met à symboliser l’inverse de l’urbanité d’Athènes : la nature sauvage ; et cette vision échappe aux Arcadiens, pour devenir propre à Athènes puis, de là, se répandre dans tout le monde gréco-romain.
Cette subtilisation, par la ville, de quelque chose qui au départ lui était extérieur (relevant du monde paysan), et qu’elle s’approprie pour le réinterpréter en quelque chose qui est son inverse propre : la nature, mais qu’elle diffusera ensuite à partir d’elle-même et pour elle-même (donc hors de portée des paysans), c’est ce que j’appelle le principe de la grotte de Pan. C’est un principe paradoxal, où « la nature » (l’idée de nature et sa représentation sensible, telle une grotte) tient lieu de la nature (les écosystèmes non anthropisés) ; et ce dans la mesure même où la ville (ce qu’il y a de plus artificiel sur Terre) est à l’opposé de la nature.
C’est là suggérer que « la nature » n’est pas un en-soi, mais qu’elle existe en tant que telle – en tant que « la nature » – seulement pour une certaine société (urbaine, justement pas sauvage ni même paysanne), et seulement à partir d’un certain moment de l’histoire.
§ 4. Exister en tant que
Pour Ulysse, Hermès a tiré de la terre le môlu en tant que remède. Il l’a fait exister en tant que tel, i.e. comme remède. Cet « exister en tant que » est l’essence de la relation mésologique, laquelle vaut aussi bien dans les milieux humains que dans les milieux animaux et même végétaux, c’est-à-dire pour la nature elle-même. Effectivement, ce principe a été entrevu d’abord par un naturaliste, Jakob von Uexküll (1864-1944), dont les travaux ont ouvert la voie de l’éthologie et de la biosémiotique en montrant que chaque espèce donne un sens particulier à son environnement. Celui-ci n’est donc pas le donné environnemental en soi (ce qu’Uexküll appelle l’Umgebung), mais cet environnement interprété par l’animal dans un certain sens, sens qui en fait son milieu propre (ce qu’Uexküll appelle l’Umwelt).
Cette opération produit ce qui est la réalité pour l’animal en question. Elle suppose que l’animal n’est pas une machine, mais un machiniste capable d’interprétation, c’est-à-dire un sujet. Dans Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen (Incursions dans les milieux d’animaux et d’humains, 1934), où il reprend les apports essentiels de sa longue recherche, Uexküll écrit d’emblée dans l’introduction :
« Quiconque veut s’en tenir à la conviction que les êtres vivants ne sont que des machines, abandonne l’espoir de jamais entrevoir leurs milieux (ihre Umwelten). (…) Les animaux sont ainsi épinglés comme de purs objets (reinen Objekten). On oublie alors que l’on a d’emblée supprimé l’essentiel, à savoir le sujet, celui qui se sert des moyens (das sich der Hilfsmittel bedient), perçoit avec eux et agit avec eux (mit ihnen merkt und mit ihnen wirkt). (…) Mais qui considère encore que nos organes sensoriels servent notre perception, et nos organes moteurs notre action, ne verra dans les bêtes pas seulement un appareillage mécanique, mais en découvrira aussi le machiniste (den Maschinisten), lequel est incarné dans les organes tout comme nous-mêmes le sommes dans notre corps. Alors il ne s’adressera plus aux animaux comme à de simples objets, mais comme à des sujets (als Subjekte), dont l’activité essentielle consiste à percevoir et agir »[17].
La suite du livre apporte une moisson de preuves issues de l’expérimentation scientifique à l’appui de cette thèse, aussi renversante que le furent en leur temps celles de Copernic ou de Darwin : le vivant est doué de subjectité. Comme tel, il fait du donné environnemental son milieu propre, spécifiquement adapté à son espèce, et aux termes duquel il s’adapte lui-même, créativement, dans un cercle vertueux de son propre monde. Ainsi, dans le même environnement, le milieu de telle espèce n’est pas celui de telle autre. Pour la même raison, tel environnement invivable pour la plupart peut être le milieu optimal de certaines espèces, dites extrémophiles, comme les avancées ultérieures de la biologie n’ont cessé d’en découvrir ; tel ce Pyrolobus fumarii qui est à l’aise en eau hyperthermale (il se reproduit encore à 113°), ou ce Thermococcus gammatolerans qui est non seulement thermophile, mais supporte en outre de fortes radiations. Cela concerne même des organismes pluricellulaires, tel le ver Alvinella pompejana, qui vit à plus de 80° dans des cheminées hydrothermales[18].
Ainsi n’a cessé de se confirmer la règle qu’Uexküll a découverte : l’environnement serait-il pessimal, le milieu est optimal pour l’être concerné[19] ; car il y a une adéquation mutuelle, un accord entre le milieu et l’espèce. Parler de « réalité objective » en l’affaire n’est qu’une abstraction : il est prouvé par l’expérimentation que, selon les termes d’Uexküll, « qu’un animal puisse jamais entrer en relation avec un objet, cette hypothèse tacite [celle du béhaviorisme] est fausse »[20]. Ce avec quoi il entre en relation, c’est-à-dire ce qui est pour lui la réalité, ce sont les choses propres à son milieu, pas les objets universels de l’environnement, tels qu’ils peuvent exister pour la science écologique.
Cela vaut évidemment aussi pour les êtres humains. Donnons-en un exemple précis. Une radiation électromagnétique de λ = 700 nm (nanomètres) est une donnée physique universelle. Dans notre espèce, Homo sapiens, cette longueur d’onde est perçue (interprétée) en tant que couleur rouge. Elle existe en tant que rouge. Dans l’espèce Bos taurus (la vache), cette même longueur d’onde n’est pas perçue comme une couleur. Pour un taureau, le rouge n’existe pas. Il ne peut donc pas entrer en relation avec le rouge, comme dirait Uexküll. Ce qui l’excite, ce n’est pas la couleur de la muleta, ce sont les gesticulations du toréador. De même, l’œil humain ne perçoit pas les infrarouges, que perçoit l’œil du serpent. Il ne perçoit pas les ultraviolets, que perçoit l’œil du papillon[21]. Etc. En outre, à cette spécification des choses propre à l’espèce humaine, se greffe une spécification supplémentaire, propre à chaque culture. Le rouge, par exemple, n’est pas la couleur des robes de mariées en Europe ; mais il l’est au Japon. Il est le signal de l’arrêt pour l’automobiliste moyen, mais pour les gardes rouges de la Révolution culturelle, il voulait dire : en avant ! Etc.
Le principe de cette institution de la réalité, c’est ce que la mésologie appelle trajection[22]. Cette opération s’apparente à une prédication, dans laquelle le sujet logique S (ce dont il s’agit) est interprété en tant que prédicat P (ce que l’on dit à propos du sujet) ; mais elle est évidemment beaucoup plus générale que la prédication, qui relève du seul verbal. Dans la réalité d’un milieu humain, la trajection est opérée sur quatre modes complémentaires : par les sens, par la pensée, par la parole et par l’action. Le principe est cependant le même que celui de la prédication, et il peut se représenter par la même formule : « S en tant que P » ; soit S/P. Par exemple : « λ = 700 nm (S) en tant que rouge (P) » ; « rouge (S) en tant que stop (P) » ; etc. Ou pour l’animal, par exemple un guépard : « antilope en tant que proie ». Ou pour une feuille de chêne : « lumière du soleil en tant qu’énergie pour la photosynthèse » ; etc. Ou, pour en revenir à Homère : « môlu en tant que pharmakon ».
§ 5. Du Mesnage des champs à la Femelle obscure
Le principe de la trajection ne fait pas seulement accéder un en-soi brut à une réalité pleine de sens ; il le fait exister en tant que quelque chose, à partir d’un simple potentiel. Pour nous le rouge existe, mais son « sujet » (λ = 700 nm) n’a existé pour nous qu’à partir du moment où la science moderne l’a découvert en tant qu’onde électromagnétique. Autrement dit, la réalité est trajective. Elle est S/P, tandis que S n’est qu’un potentiel qui, dans un certain monde, n’accède à l’existence qu’à tel ou tel moment de l’histoire ou de l’évolution. Certes, le dualisme moderne nous laisse penser que la réalité objective, c’est S, et que le reste n’est que subjectif. C’est là une illusion. La réalité que nous saisissons ne peut qu’être trajective, qu’il s’agisse de l’opinion commune ou de la science. Aussi objective en effet que soit la science, elle ne peut jamais saisir S qu’en tant que quelque chose, c’est-à-dire S/P. La physique elle-même en administre la preuve : le rayonnement lumineux n’est pas saisissable en lui-même (S), mais soit en tant qu’onde (P), soit en tant que corpuscule (P). Ce n’est pas là une histoire d’objectivité ou de subjectivité ; c’est la réalité (S/P), qui est donc trajective dès le niveau quantique.
Mais laissons le quantique de côté, pour en revenir à notre échelle. La trajectivité des choses implique non seulement S (l’en-soi de la chose) et P (ce comme quoi elle apparaît), mais nécessairement aussi un tiers terme : l’interprète de S en tant que P, c’est-à-dire l’instance pour laquelle S existe en tant que P. Il y a donc là un rapport ternaire entre S, P, et I : l’interprète ; ce qui s’apparente au principe de la sémiotique de Peirce, qui a été repris dans la biosémiotique de Hoffmeyer[23]. Et comme le processus de la sémiose peircienne, la trajection peut indéfiniment se poursuivre. Par exemple, le rouge, qui est une réalité S/P, peut être surprédiqué en une nouvelle réalité en tant que « stop ! » ; ce qui est donc (S/P)/P’. Et ainsi de suite : (((S/P)/P’)/P’’)/P’’’…
Dans cette suite trajective, l’assomption de S en tant que P, engendrant la réalité S/P, donne lieu à l’assomption ultérieure de S/P en tant que P’, soit (S/P)/P’, etc. ; c’est-à-dire en fin de compte que P, ou P’ etc., se trouve indéfiniment placé en position de S, puis de S’ etc. vis-à-vis d’un prédicat ultérieur P’, P’’ etc. Ce processus, où un prédicat devient sujet, c’est ce qu’on appelle une hypostase : la substantialisation d’une insubstance[24]. La trajection est donc une suite d’assomptions et d’hypostases de ces assomptions. Donnons-en un exemple concret :
Vers le IVe siècle de notre ère, en Chine du sud, pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, la nature (S) a été perçue en tant que paysage (P)[25]. Puis le paysage est devenu le sujet (S’) de représentations jardinières, à savoir le jardin paysager (P’). Le même phénomène s’est reproduit plus tard en Europe, respectivement à la Renaissance et au XVIIIe siècle. Il y a donc eu hypostase du paysage (P) dans la matérialité des jardins. Ou encore, au XXe siècle, dans les aménagements touristiques, les routes et les résidences secondaires qui ont hypostasié le paysage – à l’origine une simple manière de percevoir la nature – en réalités géographiques on ne peut plus palpables, sujet à leur tour de nouvelles assomptions, et ainsi de suite.
Dans ces suites trajectives, la diversité virtuellement infinie des assomptions de S en tant que P se ramène à quatre grandes catégories : ressources, contraintes, risques et agréments. Dans l’exemple de l’Odyssée, le môlu est assumé en tant que pharmakon positif : un remède, c’est-à-dire une ressource ; mais il y a là aussi un risque potentiel, car le mésusage d’un pharmakon en fait un poison. Quand le seigneur du Pradel, Olivier de Serres (1539-1619), écrivait son Théâtre d’agriculture et mesnage des champs, il assumait essentiellement la nature en tant que ressource permettant de se nourrir, mais aussi en tant que risque de gelée, de sécheresse etc. :
Deux espèces de thym y a-t-il, qu’on discerne à la fleur, la plus blanche estant la meilleure. Les deux viennent naturellement ès coustaux secs et arides, dont ils ont la racine fort dure. Par plant enraciné et par bouteures l’on se meuble de thym. (…) Les abeilles et les connins aiment fort la fleur de thym, aussi leur acquiert-elle bonté de miel et de chair, accompagnée d’odorante senteur (…).
Estant chose très-asseurée, que peu de saules se sauvent qu’on esbranche en sève, ou ès grandes froidures. Les plus robustes de ces arbres, seront choisis pour estre couppés devant l’hyver, afin de mieux résister aux injures prochaines, que les jeunes et minces. A quoi aidera l’advancer en telle action, c’est-à-dire, n’attendre que le mauvais temps presse, ains le prévenant, y mettre la main en la bonnasse des restes des jours de l’automne (…)[26].
Pour les organisateurs du présent colloque, cette même nature est assumée surtout en tant qu’agrément, pour un « usage récréatif ». Telle est en effet aujourd’hui, pour la plupart d’entre nous, la réalité de la nature. Mais, comme toute réalité, c’est une réalité trajective : elle est vouée à ce qu’on l’assume un jour en tant qu’autre chose, donc à devenir une autre réalité.
« La nature », en somme, sera toujours à naître, comme le dit si bien le choix que les Romains ont fait pour traduire phusis : prendre le participe futur du verbe naître (nasci) au féminin (natura). Pourquoi au féminin ? Parce que phusis est féminin, certes, mais surtout parce que donner l’existence, par la naissance (genesis), est une puissance féminine. On dit la même chose à l’autre bout du monde, en Chine, à propos de la puissance d’engendrement de la nature, bien qu’il n’y ait en chinois ni masculin ni féminin :
谷神不死
|
Gu shen bu si
|
Le génie de la vallée ne meurt pas
|
是謂玄牝
|
Shi wei Xuanpin
|
On l’appelle la Femelle obscure
|
玄牝之門
|
Xuanpin zhi men
|
La porte de la Femelle obscure
|
是謂天地根
|
Shi wei tian di gen
|
S’appelle la racine du ciel et de la terre
|
綿綿若存
|
Mianmian ruo cun
|
Comme file un fil elle dure
|
用之不勤
|
Yong zhi bu jin
|
En user ne l’épuise[27]
|
La porte de cette « Femelle obscure », Xuanpin, n’est pas autre chose que ce qu’a représenté Courbet avec L’Origine du monde. Et c’est là bien davantage qu’une simple représentation, bien davantage que la seule histoire humaine de notre relation à la nature[28] : l’histoire naturelle tout entière, indéfiniment, est à naître d’elle-même. Ziran 自然, de soi-même ainsi, la nature sera toujours à naître : natura natura semper.
Palaiseau, 13 mars 2013.
Note complémentaire : des textes connexes peuvent être consultés sur le présent site ; notamment « Mésologie », « Cette femelle obscure qui règne à l’occident : la nostalgie de l’origine en Asie orientale », « Le rural, le sauvage, l’urbain », et « La naissance du paysage en Chine ».
[1] Andrew D. WHITE, A History of the Warfare of Science with Theology and Christendom, New York, Braziller, 1955, p. 9.
[2] HOMÈRE, Odyssée, X, 302-306. Traduction Victor Bérard (un peu modifiée), Paris, Les Belles Lettres, 2002.
[3] En l’occurrence dans Barbara CASSIN (dir.) Vocabulaire européen des philosophies, Seuil/Le Robert, 2004, article « Nature », p. 855.
[4] Je tire ces notations philologiques de R. Grandsaignes d’Hauterive, Dictionnaire des racines des langues européennes, Paris, Larousse, 1948, et du Dictionnaire historique de la langue française, Paris, Le Robert, 1998 .
[5] Laozi, 25, éd. par OGAWA Kanju, Tokyo, Chuôkôron, 1973, p. 53.
[6] Jean CHEVALIER et Alain GHERBRANT (dir.), Dictionnaire des symboles, Paris, Laffont, 1982, p. 500.
[7] Ce dieu que l’on révérait à Lugdunum (« citadelle de Lug »), toponyme qui est devenu « Lyon ».
[8] Odyssée, op. cit., chants VIII à XV, note 25 p. 113.
[9] Pour ce qui suit, je reprends un passage de mon Histoire de l’habitat idéal. De l’Orient vers l’Occident, Paris, Le Félin, 2010, p. 89 sqq.
[10] Philippe Borgeaud, Recherches sur le dieu Pan, Genève, Droz, 1979, p. 73 et p. 15.
[11] Borgeaud, op. cit., p. 16, 18, 19.
[12] Nicole Loraux, Né de la terre. Mythe et politique à Athènes. Paris, Seuil, 1996, p. 67-68.
[13] Sur ce qui suit, v. Borgeaud, op. cit., p. 195 sqq. : « Pan à Athènes ».
[14] Athènes l’avait envoyé porter un message à Sparte, et il était là sur le chemin du retour. C’est ce même Philippidès (ou Phidippidès) qui, après la victoire de Marathon, courra d’une traite annoncer la nouvelle à Athènes ; exploit que commémore aujourd’hui, depuis la réinstitution des jeux olympiques, la course du marathon.
[15] Borgeaud, op. cit., p. 222.
[16] Loraux, op. cit., p. 67.
[17] P. 21-22 dans l’édition 1965, Hambourg, Rowohlt.
[18] Wikipédia, « Extrémophile », consulté en ligne. Cet article substantiel donne une bonne bibliographie.
[19] Op. cit., p. 29 note 1 : « Optimale, d. h. denkbare günstige Umwelt und pessimale Umgebung wird als allgemeine Regel gelten können”. La traduction de Philippe Muller (Mondes animaux et monde humain, Paris, Denoël, 1965) donne ici « Un milieu optimal associé à un entourage pessimal, voilà la règle générale ». Celle de Charles Martin-Freville (Milieu animal et milieu humain, Paris, Payot & Rivages, 2010) : « Un milieu optimal, c’est-à-dire le plus favorable qu’on puisse imaginer, et un environnement pessimal peuvent valoir comme une règle générale ».
[20] «(…) die stillschweigende Voraussetzung, ein Tier könne jemals mit einem Gegenstand in Beziehung treten, falsch ist ». Op. cit. p. 105.
[21] Données glanées dans HIDAKA Toshitaka, Dôbutsu to ningen no sekai ninshiki. Iryûjon nashi ni sekai wa mienai (La cognition du monde chez l’animal et chez l’humain. Sans l’illusion, le monde est invisible), Tokyo, Chikuma, 2003, passim.
[22] Sur ce thème, v. mon Écoumène. Introduction à l’étude des milieux humains, Paris, Belin, 2000. Sur l’origine du terme de trajection, v. mon Le sauvage et l’artifice. Les Japonais devant la nature, Paris, Gallimard, 1986.
[23] Jesper HOFFMEYER, Signs of Meaning in the Universe. Bloomington & Indianapolis, Indiana University Press, 1996 (1993).
[24] Pour Aristote, le prédicat (kategorêma) est insubstantiel. La substance (ousia, hupostasis), c’est le sujet (hupokeimenon).
[25] Sur ce thème, v. mon Histoire de l’habitat idéal, op. cit., et plus spécialement mon Thinking through landscape, Abingdon, Routledge, 2013.
[26] Olivier de SERRES, Le Théâtre d’agriculture et mesnage des champs, Arles, Actes Sud, 1996 (1600), p. 876 et 1192.
[27] Laozi, 6, op. cit. p.16.
[28] Ce n’est pas le lieu d’aborder la question, mais ce postulat ne se résout pas en un simple constructivisme. Pour la mésologie en effet, il y a trajection dès l’origine de la vie sur Terre, tout vivant assumant l’environnement brut en tant que quelque chose qui lui est propre, et le transformant ainsi un milieu qui, en retour, le transforme lui-même. La trajection est en somme le principe de l’évolution : une suite d’assomptions et d’hypostases. On ne peut nullement la réduire à une simple représentation de la réalité : elle produit la réalité, physiologie comprise.