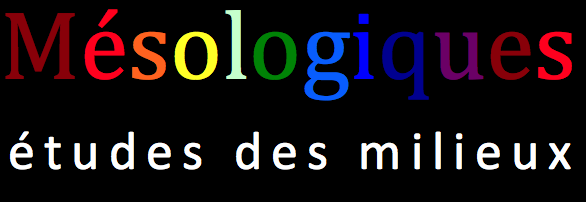|
| Ashida, extrait des Soixante-neuf Stations du Kiso Kaidō Utagawa Hiroshige (source) |
– Journée d’étude du 28 janvier 2017 –
Maison de la recherche de l’Université Paris-Sorbonne
Forêts, arts et culture : lieux de récits et esprits des lieux
Existe-t-il un mode de pensée forestier ?
par Augustin Berque
Résumé – On rappelle d’abord la distinction mésologique entre milieu et environnement (Umwelt et Umgebung chez Uexküll, fûdo et kankyô chez Watsuji). Dans un milieu humain, la réalité d’une forêt n’est pas seulement écologique, elle est éco-techno-symbolique. Cette réalité n’est ni seulement objective, ni seulement subjective, elle est trajective. On brosse ensuite un tableau écologique des formations végétales au Japon, avant de montrer la prégnance du végétal dans la civilisation japonaise. Il n’y a pas là détermination causale de la culture par l’environnement, mais identification de la culture à son milieu par des chaînes trajectives, fonctionnant comme les « chaînes sémiologiques » barthésiennes. On termine sur l’hypothèse que la profusion de la vie dans la forêt de mousson a peut-être favorisé une disposition à penser la complexité du concret.
Palaiseau, 24 janvier 2017.
Plan : 1. L’approche mésologique des
forêts ; 2. Les forêts japonaises ; 3. Le végétal dans la culture
japonaise ; 4. Chaînes sémiologiques et chaînes trajectives ; 5.
« Pensée forestière, pensée désertique » ; 6. Pensée forestière
et mésologie.
1. L’approche mésologique des forêts
Précisons
tout de suite qu’il ne s’agira pas ici de biosémiotique, ni a fortiori de bioherméneutique. Je ne
suis pas encore, et ne serai sans doute jamais en mesure de poser, comme déjà
le font certains chercheurs en écologie végétale, la question « à quoi
pensent les plantes ? »[1]. Encore
moins la question « les forêts pensent-elles ? », qui est
beaucoup plus complexe, et de nos jours encore passerait facilement pour une
absurdité. Je suis pourtant persuadé que tous les êtres vivants, à quelque
degré que ce soit, sont dotés de la capacité d’interpréter leur environnement
dans un sens qui est propre à chacun, ou du moins à chaque espèce ;
capacité interprétative qui n’est autre que l’ancêtre et le substrat de toute
pensée, humaine y compris. Même au niveau le plus primitif, c’est accomplir
déjà l’analogue du jugement prédicatif « S est P », en saisissant S
(l’environnement) en tant que P (une ressource, une contrainte, un risque, un
agrément) par les sens et par l’action – cela concerne tous les êtres vivants
–, par la pensée – cela concerne les animaux supérieurs –, et par la parole –
ce qui, double articulation oblige, ne concerne jusqu’à nouvel ordre que le
seul animal possédant la parole : le zôon
logon echôn, i.e. nous autres humains. Toutefois, n’étant pas assez formé
dans les sciences naturelles, c’est de ces derniers seulement que je vais
m’occuper ici, en me posant la question ambivalente : « comment les
humains pensent-ils les forêts ? » et « la manière dont ils les
pensent peut-elle avoir quelque chose de forestier ? ».
Seconde précision. La manière
classique de répondre à une telle question serait de recenser, en ethnologue,
les modes de pensée des diverses ethnies vivant encore ou ayant vécu en milieu
forestier, essentiellement de chasse, cueillette et pêche, et de voir si ces
modes de pensée ont quelque chose de particulier par rapport à ceux de sociétés
au genre de vie non forestier. Or même de seconde main, je ne tenterai pas la
chose, parce que c’est d’un autre point de vue que je conçois la question.
Ce point de vue, c’est celui de la mésologie –
la Umweltlehre d’Uexküll, le fûdoron 風土論
de Watsuji[2]. Cela
consiste d’abord à distinguer le milieu (Umwelt,
fûdo 風土) de
l’environnement (Umgebung, kankyô 環境). L’environnement, donnée
brute et universelle, n’est que la matière première du milieu, qui est la relation
spécifique établie avec son environnement par un certain sujet, individuel ou
collectif (une espèce, une société). L’environnement fait l’objet de
l’écologie, science moderne supposant
l’abstraction de l’observateur hors de la relation qu’est son milieu. Les
milieux font l’objet de la mésologie, science
transmoderne reconnaissant que l’observateur ne peut jamais s’abstraire
parfaitement de son milieu. C’est là non seulement une position métaphysique et
phénoménologique, mais un fait constaté et prouvé par la physique depuis
bientôt un siècle :
« S’il est permis de
parler de l’image de la nature selon les sciences exactes de notre temps, il
faut entendre par là, plutôt que l’image de la nature, l’image de nos rapports
avec la nature. (…) C’est avant tout le réseau des rapports entre l’homme et la
nature qui est la visée de cette science. (…) La science, cessant d’être le
spectateur de la nature, se reconnaît elle-même comme partie des actions
réciproques entre la nature et l’homme. La méthode scientifique, qui choisit,
explique, ordonne, admet les limites qui lui sont imposées par le fait que
l’emploi de la méthode transforme son objet, et que, par conséquent, la méthode
ne peut plus se séparer de son objet »[3].
Que
la méthode ne puisse se séparer de l’objet, c’est dire que l’objet, en fait,
n’est pas un pur objet. Contrairement à ce que posait dans l’abstrait le
dualisme moderne, son existence est en relation concrète avec celle de
l’observateur, serait-ce par dispositif instrumental interposé.
Corrélativement, l’observateur aussi est pris dans cette relation. Il ne peut
pas s’en abstraire pour se poser, de son seul fait, en un pur cogito. Pas plus que la res extensa ne peut donc être purement
objective, la res cogitans non plus ne
peut être purement subjective. Elles
sont l’une et l’autre trajectives,
c’est-à-dire que, concrètement, elles sont en relation mutuelle et se
construisent l’une l’autre. Ce ne sont pas ces deux pôles théoriques et
abstraits, le sujet et l’objet, propres au paradigme
occidental moderne classique (ci-dessous abrégé en POMC) ; elles sont concrescentes,
c’est-à-dire qu’elles croissent ensemble (cum
crescere, d’où le participe concretus)
dans une certaine histoire corrélative : celle du milieu dont elles
relèvent l’une et l’autre, l’une en fonction de l’autre.
C’est dire, pour commencer, qu’un
milieu humain ne peut se réduire à l’ensemble d’écosystèmes qu’est
l’environnement. Il est proprement humain, à savoir qu’il est également cet
ensemble de systèmes techniques et symboliques dans lequel nous vivons
concrètement. C’est un système éco-techno-symbolique. Corrélativement, l’être
humain aussi est irréductible à la physiologie de son corps animal individuel.
Comme l’a montré Leroi-Gourhan[4],
notre espèce a émergé par extériorisation et déploiement de certaines des fonctions
de notre corps animal sous forme de systèmes techniques et symboliques,
constituant ce qu’il appelait notre corps
social, et par rétroaction de ce corps social sur le corps animal,
provoquant son hominisation. Pour la
mésologie toutefois, le corps social s’inscrivant nécessairement dans les
écosystèmes de la biosphère, il n’est pas seulement social ; c’est notre corps médial, i.e. notre milieu
éco-techno-symbolique. Entre le corps animal, qui est individuel, et le corps
médial, qui est collectif, il y a un couplage dynamique ; c’est ce qu’Uexküll
appelait Gegengefüge, le
contre-assemblage ou l’appariement de l’animal et de son milieu, et Watsuji fûdosei 風土性,
ce qu’il définissait comme « le moment structurel de l’existence
humaine », et que j’ai traduit par médiance.
En ce sens, les forêts de notre
milieu ne sont pas de simples écosystèmes ; elles font partie de notre
corps médial, éco-techno-symbolique. C’est en ce sens que je poserai la
question « existe-t-il un mode de pensée forestier ? », à propos de
quelques exemples concrets choisis dans le milieu nippon – Nihon no fûdo 日本の風土.
2. Les forêts japonaises
Le
Japon est aux deux tiers couvert de forêts, auxquelles l’allongement
latitudinal, la mousson, la variété géologique et la montuosité confèrent une
richesse florale peu commune[5]. La végétation
naturelle, au niveau de la mer, compte du sud au nord cinq formations
principales, auxquelles il faut ajouter une ou deux zones de végétation
d’altitude :
-
Dans les îles du sud (Okinawa etc.), les forêts sont de type subtropical,
pluviales, sempervirentes, très riches en espèces, avec des associations
complexes marquées par la présence de fougères arborescentes, de lianes, de
feuillus comme le banian, etc.
-
Les plaines méridionales des grandes îles – jusqu’au Kantô versant Pacifique,
jusqu’à l’île de Sado versant mer du Japon – étaient primitivement couvertes
par une formation originale : la laurisylve, ou forêt à feuilles
luisantes, zone de végétation qui prend en écharpe l’Asie des moussons vers les
vingtième et trentième parallèles, du Népal au Japon. Cette zone se caractérise
par des feuillus toujours verts, aux feuilles généralement petites et épaisses,
dures, luisantes, qui se protègent du froid hivernal de diverses façons :
poils, écailles, cire etc. Les espèces représentatives sont le chêne vert, le
laurier, le pasania shii, avec en
sous-bois canneliers, camélias, théacées – c’est la zone de la culture du
thé… Au-dessus de cette formation, soit
de 800 à 1400 m environs à Kyûshû, vers 300-400 m dans le Kantô, le climax est
celui d’une forêt intermédiaire, mixte, avec des résineux comme le cyprès hinoki, le cèdre sugi, le sapin tsuga, le
pin parasol, le sorbier, le hêtre F.
japonica, etc.
- Au
nord du Kantô, cette zone altitudinale disparaît. Dans le Tôhoku, l’on trouve
au niveau de la mer la forêt tempérée froide qui la surmonte à Kyûshû. Celle-ci
s’étend jusqu’au sud de Hokkaidô, dans la péninsule d’Oshima. Elle est
caractérisée par des arbres à feuilles caduques comme le hêtre F. crenata, le marronnier, le chêne
blanc mizu-nara. Les bambous,
nombreux plus au sud, laissent ici la place au bambou nain sasa ; d’où le nom de « formation à hêtre et sasa », laquelle domine du côté
Pacifique, tandis que le hêtre s’associe au houx du côté de la mer du Japon.
-
Plus au nord, dans le corps principal de Hokkaidô, les plaines étaient
originellement couvertes par la forêt boréale à résineux (que l’on trouve vers
1500-2500 m dans les Alpes japonaises), avec sapins, épicéas et bouleaux. Il en
reste encore de vastes ensembles, notamment dans l’est. Le sous-bois est
souvent constitué de sasa.
-
Enfin, l’étage que l’on trouve au dessus de 2500 m dans le centre de Honshû, de
1500 m dans le nord du Tôhoku, et à quelques centaines de mètres dans les
Kouriles japonaises[6], est une brousse
d’altitude avec pin rampant haimatsu.
Il
va sans dire que, dans les plaines, l’occupation humaine a profondément modifié
cette végétation. Certaines formations représentatives ont presque disparu du
fait des défrichements, notamment la forêt à feuilles luisantes qui ne subsiste
plus guère que dans les bois sacrés des sanctuaires shintô (chinju no mori 鎮守の森). C’est dire son lien avec
l’identité japonaise, que l’on a pu qualifier de « culture de la
laurisylve » (shôyô jurin bunka 照葉樹林文化)[7]. Ailleurs, la forêt primaire a généralement laissé place à la forêt secondaire
et aux reboisements. Il faut néanmoins souligner que, par rapport aux pays
comparables, le Japon a gardé une grande partie de son territoire en forêts
(les deux tiers), et que ces forêts sont encore assez largement
naturelles : environ le quart n’ont pas subi d’influences anthropiques
notables, et ce n’est que vers 1970 que les superficies reboisées
artificiellement ont dépassé les superficies boisées ou reboisées
naturellement. La forêt reste donc une réalité géographique massive.
3. Le végétal dans la culture japonaise
Cette
réalité géographique massive est aussi une réalité culturelle omniprésente. Non
seulement les Japonais utilisent beaucoup le bois, mais ils ont très fortement
conscience qu’il s’agit là d’un paradigme de leur culture. Témoin, entre mille
exemples, le livre de Haga Yaichi[8] Dix thèses sur le caractère national nippon
(Kokuminsei jû ron)[9],
qui connut un grand succès au début du siècle dernier. L’ouvrage comprenait dix
chapitres, respectivement consacrés à un trait remarquable de la
japonité ; à savoir 1. Loyauté et patriotisme ; 2. Culte des
ancêtres, respect de l’honneur familial ; 3. Attachement au présent et au
pratique ; 4. Amour du végétal, jouissance du naturel ; 5. Optimisme
et détachement ; 6. Goût du délié, raffinement ; 7. Délicatesse,
agilité ; 8. Goût de la propreté et de la pureté ; 9. Politesse et
réserve ; 10. Calme et indulgence.
Ces divers caractères, notamment
celui classé en premier, portent bien entendu la marque de l’époque, les
dernières années du règne de Meiji ; mais intéressons-nous ici au chapitre IV,
celui qui nous parle de l’amour de la nature, et plus particulièrement des
plantes. Comme il est fréquent dans ce genre littéraire (qu’on appelle au Japon
nihonjinron 日本人論,
« nippologie »), ce caractère des Japonais leur viendrait directement
de la nature elle-même : douceur du climat, beauté du relief et de la
végétation feraient « naturellement (shizen
自然) » et « bien
évidemment (tôzen 当然) » que les Japonais
aiment la nature, et en particulier le végétal[10]. On
notera que Haga, de la manière classique, emploie shizen adverbialement, alors qu’aujourd’hui ce terme est devenu
quasi exclusivement un substantif, l’équivalent de notre « nature ». Shizen est la lecture on (dérivée phonétiquement du chinois)
des sinogrammes自然, qui en
chinois se lisent ziran. C’est un
terme venu du taoïsme. En japonais, il se lit également jinen dans le bouddhisme, mais aussi onozukara shikari en lecture kun (rendant
phonétiquement les sinogrammes en lecture proprement japonaise). Là, le sens
classique de ziran, à savoir
« de soi-même ainsi », est conservé à l’évidence. Or cette notion
implique une forte prégnance du social dans le naturel, autrement dit la
trajectivité d’un certain milieu, lequel ne saurait être cet universel objectal
qu’est devenue la nature dans le POMC. Traditionnellement, shizen, plus encore jinen,
et à plus forte raison onozukara shikari,
c’était la médiance même du milieu nippon. C’était le Japon – un
« soi » (ji 自) appariant concrètement
l’archipel physique et la nation qui l’habitait. Et c’est visiblement dans ce
sens-là que Haga emploie shizen.
Poursuivons
son propos. Haga montre que les Japonais utilisent profusément le végétal pour
leur vêtement, leur nourriture, leur habitation. De même, le végétal domine
leur esthétique, par exemple la décoration des kimonos. Même les geta 下駄
(socques de bois très rudimentaires) sont ornés d’un motif végétal à leur
attache. Les noms de couleurs viennent largement du domaine végétal :
« couleur cerisier (sakura iro 桜色, un certain rose) »,
« couleur pêche (momo iro 桃色, un rose un peu plus foncé) »,
« couleur corête (yamabuki iro 山吹色, jaune d’or) »,
« couleur raisin (budô iro 葡萄色[11], bordeaux) »… La décoration des armures, les emblèmes, les armoiries kamon 家紋 ont pour motif le
végétal (par exemple le chrysanthème pour la maison impériale). Celui-ci régit
encore la terminologie culinaire, témoins ces noms de gâteaux
traditionnels : « vent dans les pins (matsu kaze 松風)[12] »
– lequel est aussi un genre de théâtre nô, de musique et de danse – ,
« pin sur la grève (iso matsu 磯松) », ce qui est aussi un
assortiment de sushi, etc. Dans les auberges[13] les
noms des chambres, l’habillement des servantes et leurs surnoms mêmes : o-Hana (Fleur), o-Matsu (Pin), o-Ume
(Prunier), viennent directement du
végétal. Les arts portent souvent sur le végétal, soit directement comme dans
l’art floral et les jardins en boîte ou sur plat comme les fameux bonsai 盆栽
(« plantations sur plat »), soit indirectement, comme motif en
peinture ou en littérature. Souvent même aussi les jeux : témoin le hana awase 花合わせ, littéralement « assemblage
des fleurs », dérivé pourtant de jeux de cartes appris de l’Europe… Enfin
l’architecture utilise beaucoup le végétal, tant pour les structures que pour
les aménagements, avec les tatamis, le papier des cloisons… ; elle le fait
en outre systématiquement jouer comme environnement du bâti (le jardin sur
lequel ouvre traditionnellement la maison).
Haga ne déformait pas la
réalité : par mille facettes, la vie des Japonais les référait en effet
quotidiennement au végétal ; et cela reste en grande partie vrai même
aujourd’hui. Cependant, il fondait en nature une tendance culturelle dont rendent
largement compte – ce que le livre passe sous silence – certaines influences
reçues de la civilisation chinoise, ainsi d’ailleurs qu’une élaboration
historique proprement japonaise[14]. Largement
compte, mais non point totalement compte ; car si l’introduction des
schèmes esthétiques de la Chine (notamment la tradition de l’érémitisme
mandarinal)[15], et leur transformation
par la créativité japonaise, peuvent être datées et décrites avec une relative
certitude, il n’en va pas de même quant aux dispositions profondes qui font que
la thématique végétale a pu se développer à tel point dans l’esthétique
japonaise.
Les arguments que l’on invoque à ce
sujet restent le plus souvent de l’ordre de ceux que nous livre Haga ; à
savoir, tautologiquement, que c’est la beauté et la générosité de la nature qui
feraient qu’on l’aime et la trouve belle. On ira même jusqu’à montrer que si
les Japonais sont si attachés à la nature de leur pays, c’est par définition du
fait que le Japon est très beau, et que « beau » (utsukushii 美しい) s’écrivait autrefois avec
le caractère « amour », soit
utsukushii 愛しい. Ces
naïvetés circulaires ne font qu’illustrer une règle mésologique mise en lumière
par Uexküll, à savoir que, l’environnement serait-il pessimal pour d’autres
espèces, le milieu est toujours optimal pour l’espèce concernée, puisque c’est
le sien propre et que son être en est indissociable. C’est ce même effet de
médiance, ou de cosmophanie,
qu’illustrait Platon – mais sans le savoir – lorsqu’il écrivit, dans les
dernières lignes du Timée, cette phrase a
priori surprenante : « très grand, très bon, très beau et très
parfait (megistos kai aristos kallistos
te kai teleôtatos), le Monde (ho
kosmos) est né : c’est le ciel, qui est un (heis ouranos) et seul de sa race (monogenês) ». Le monde de l’humain Platon ne pouvait
effectivement que mériter de tels superlatifs, puisqu’il était proprement
humain : c’était la Umwelt humaine, celle propre à la seule race humaine, Platon
ignorant encore les travaux d’Uexküll. Et de même, pour les Japonais, le Japon
ne peut être qu’aristos kallistos (愛.美しい) puisque c’est leur propre fûdo ! Dans le moment structurel de leur propre
existence, c’est le corps médial de ce qu’ils sont eux-mêmes, et, comme l’écrit
Watsuji, le milieu de leur « découvrance de soi » (jikohakkensei 自己発見性)...
4. Chaînes sémiologiques et chaînes
trajectives
Cela
dit, le milieu n’étant justement pas l’environnement naturel, mais une certaine
interprétation de ce même environnement par l’histoire, il nous faut aller plus
loin que de simplement rappeler cette règle mésologique. Watsuji a mis en
lumière que si le milieu est la chair de l’histoire, c’est l’histoire qui donne
sens au milieu. L’histoire, en somme, est la suite indéfinie des prédicats P,
P’, P’’ etc. selon lesquels est saisi le donné environnemental, la Umgebung, qui se trouve là en position
de sujet logique S (ce dont il s’agit), produisant ainsi la réalité concrète du
milieu ; soit r = S/P :
la réalité qu’est le milieu – la
réalité – c’est S en tant que P.
Ce n’est pas tout. La trajection qui
fait que S apparaît, existe (ek-siste)
concrètement en tant que P, soit la cosmophanie d’un certain monde (kosmos)[16], c’est
un processus historique, lequel se formalise en chaînes trajectives où de nouveaux prédicats P’, P’’, P’’’ etc.
viennent indéfiniment surprédiquer (réinterpréter) la réalité S/P ; soit
la formule (((S/P)/P’)P’’)/P’’’…, et
ainsi de suite. Or ces chaînes trajectives sont homologues à ce que Barthes,
dans ses Mythologies (1957), appelait
« chaînes sémiologiques », lesquelles, indéfiniment, tendent à
transformer l’histoire en mythe. On sait que, pour Barthes, un signe se définit
par l’association d’un signifié Sé à un signifiant Sã ; soit la formule signe = Sã/Sé, i.e. « signifiant en tant
que signifié », laquelle est homologue à la formule r = S/P, i.e. « sujet en tant que prédicat ». On peut, de
même, représenter[17] les
chaînes sémiologiques barthésiennes comme les chaînes trajectives de la
mésologie, soit (((Sã/Sé)/ Sé’)/ Sé’’)/
Sé’’’…, et ainsi de suite.
Or si les chaînes sémiologiques
représentent la transformation de l’histoire en mythe, en quoi donc la réalité
S/P se transforme-t-elle dans une chaîne trajective ? Toujours en réalité,
certes, mais une réalité qui évolue historiquement, et dans laquelle – sauf
catastrophe, qui ramènerait au point de départ – l’insubstance des prédicats P,
P’, P’’ etc. est toujours plus prégnante. On voit en effet que, dans la formule
susdite, il n’y a qu’un S initial, mais de plus en plus de P, P’, P’’ etc. Il
faut ici rappeler, d’une part, que tant pour Aristote que pour Nishida le
prédicat est insubstantiel, et d’autre part que, dans l’histoire de la pensée
européenne depuis Aristote, le rapport substance/accident en métaphysique est
homologue au rapport sujet/prédicat en logique. Bref, le sujet est substantiel,
et le prédicat insubstantiel. Or, dans la chaîne trajective, le rapport S/P se
trouve indéfiniment placé en position de sujet S’, S’’, S’’’ etc. par rapport
aux prédicats ultérieurs P’, P’’, P’’’ etc. En somme, l’insubstance de P se
trouve de plus en plus substantialisée, ce que l’on appelle en ontologie une
hypostase.
Qu’est-ce que cela signifie ?
Que ce qui est dit à propos de S devient S. Les histoires qu’on raconte
deviennent substance, les mots deviennent des choses[18]. Or
cela, c’est le propre du mythe[19] ;
et c’est bien cela que veut dire l’homologie des chaînes trajectives et des
chaînes sémiologiques. Autrement dit, la réalité S/P est toujours tant soit peu
mythique ; et c’est justement cette hypostase qui, indéfiniment, est à
l’œuvre dans le moment structurel de l’existence : la médiance concrète de
la réalité[20].
Revenons maintenant au cas
japonais.
5. « Pensée forestière, pensée
désertique »
Le
goût du végétal n’a pas manqué d’entraîner, dans l’esprit des Japonais,
l’identification de certains des traits de leur culture à l’environnement dont
ils ont fait leur milieu. Cette identification revient à confondre, en chaîne à
la fois trajective et sémiologique, la manière (P) dont ils ont saisi cet
environnement avec cet environnement lui-même (S). Cette hypostase, c’est
l’essence mythique de ce que l’on appelle le déterminisme géographique, ou
environnemental ; à savoir l’idée que les conditions naturelles
détermineraient causalement les civilisations. Un bel exemple de ce
déterminisme nous est fourni par le géographe Suzuki Hideo, exemple d’autant
plus remarquable que Suzuki invoque expressément la mésologie de Watsuji pour
justifier ses thèses, alors que Watsuji, dès la seconde phrase de Fûdo, récusait le déterminisme :
« Ce que vise ce livre,
c’est à élucider la médiance en tant que moment structurel de l’existence
humaine. La question n’est donc pas ici
de savoir en quoi l’environnement naturel régit la vie humaine. Ce qu’on entend
généralement par environnement naturel est une chose que, pour en faire un objet,
l’on a dégagée de son sol concret, la médiance humaine. Quand on pense la
relation entre cette chose et la vie humaine, celle-ci est elle-même déjà
objectifiée. Cette position consiste donc à examiner le rapport de deux
objets ; elle ne concerne pas l’existence humaine dans sa subjectité.
C’est celle-ci en revanche qui est pour nous la question. Bien que les
phénomènes médiaux soient ici constamment mis en question, c’est en tant
qu’expressions de l’existence humaine dans sa subjectité, non pas en tant que
ce qu’on appelle l’environnement naturel. Je récuse d’avance toute confusion
sur ce point »[21].
Or c’est précisément cette confusion
que commet Suzuki, comme du reste la grande majorité des lecteurs de Fûdo, pour n’avoir pas saisi la
distinction établie par Watsuji – à la suite d’Uexküll – entre milieu et
environnement, fûdo et shizen kankyô, Umwelt et Umgebung. Alors
que Watsuji montre que le milieu est une « entente-propre (jiko ryôkai 自己了解) » du sujet humain par
lui-même, Suzuki ne voit là qu’une détermination causale de l’humain par
l’environnement. Ainsi, la manière de penser devient un effet de
l’environnement. Telle est la thèse soutenue par Suzuki dans un ouvrage
intitulé Pensée forestière, pensée
désertique (Shinrin no shikô, sabaku
no shikô)[22], dans lequel sont
contrastés, comme il est courant dans les nippologies, un modèle nippon et un
modèle occidental. La raison occidentale serait fille du désert (celui du
Proche-Orient, i.e. la tradition biblique). La pensée japonaise, elle,
s’enracinerait, via le bouddhisme, dans la forêt de mousson. Si les
Japonais n’aiment pas les grandes théories et font peu de grandes découvertes, c’est qu’ils penseraient sur le mode
forestier, cumulativement, se bornant à la proximité, sans intérêt pour
l’invisible. Cette pensée excellerait dans le particulier, pas dans le général.
Sa vision du temps serait cyclique parce que, dans la forêt de mousson, la mort
débouche toujours sur la vie, la pourriture devient exubérance ; d’où
l’idée de transmigration. Etc. Le tableau ci-dessous résume cette théorie :
FORÊT DÉSERT
Vue
de près (le particulier) Vue de loin (le général)
Pourriture :
vie Dessèchement :
mort
Temps
cyclique Temps
linéaire
Analyse Synthèse
Complexité,
accumulation Simplicité,
disjonction
Bouddhisme Christianisme
Orient Occident
L’auteur, qui était d’abord
climatologue, appuie ces conceptions sur des développements de
paléo-climatologie relativement poussés, et du reste de bonne venue. Il commet
typiquement l’erreur du scientisme, laquelle est de dévoyer le discours du
naturalisme par une extrapolation inconsidérée de la causalité aux faits
culturels, dans lesquels intervient toujours le symbolique, i.e. la métaphore.
Le lien causal que Suzuki établit entre l’environnement écologique et les
mentalités ne résisterait pas à la moindre investigation sérieuse dans
l’histoire des idées. Cela dit, les dispositions mentales qu’il qualifie de
« pensée forestière » constituent un ensemble assez cohérent, que je
ne discuterai pas ici en lui-même. Le problème, c’est de savoir quel lien cela
peut bien avoir avec la forêt de mousson ; car pour la mésologie, qui
récuse le métabasisme[23], il
y a là nécessairement un lien. Excluons d’emblée un lien causal : les
milieux ne fonctionnent pas selon des chaînes causales, ils fonctionnent selon
des chaînes trajectives, par hypostase et mythification de l’histoire, mais
toujours avec une base qui n’est autre que la substance tellurique de la Terre,
autrement dit l’environnement ; soit ici la forêt de mousson. Alors comment
la forêt de mousson (S) , par enchaînement trajectif, est-elle devenue « pensée
forestière » (P) ?
6. « Pensée forestière » et
mésologie
Je
n’ai pas la réponse, laquelle ne serait autre qu’une minutieuse histoire de la
pensée en Asie orientale : l’histoire plurimillénaire de tous les chaînons
de la chaîne trajective par laquelle S a été saisi comme P, puis P’, P’’ et
ainsi de suite, tout en maintenant indéfiniment un contact vécu, concret avec
l’environnement objectif (S). Un contact toujours immédiat, tout en étant aussi
toujours médié par la longue histoire de cette chaîne trajective, c’est-à-dire
par un certain milieu (S/P).
Ce « médiat immédiat »,
c’est bien le nœud de la question. Il va de soi qu’en logique aristotélicienne,
le médiat ne peut pas être immédiat ; car A ne peut pas être non-A, et il
n’y a pas de tierce possibilité. C’est le principe du tiers exclu, qui a dominé
la pensée occidentale jusqu’à ce que la réalité quantique nous oblige à penser
autrement. A peut aussi être non-A, une onde peut aussi être un corpuscule, et le
chat de Schrödinger peut à la fois être vivant ou mort. Cela dépend du dispositif expérimental, et à cet égard,
il y a d’intéressantes analogies à faire entre les chaînes trajectives de la
mésologie et ce que les physiciens appellent « chaînes de von
Neumann »[24] ; mais je ne
m’aventurerai pas plus avant dans ce domaine, que je ne maîtrise pas.
Je mentionnerai seulement qu’en Asie
orientale, et spécialement dans le bouddhisme du Grand Véhicule, le principe du
tiers exclu n’a pas régné aussi rigoureusement qu’il l’a fait en Occident[25].
L’on y a volontiers pratiqué le tétralemme, où A peut aussi être non-A.
Peut-être est-ce effectivement lié à la forêt de mousson, où la vie tant
végétale qu’animale est bien plus riche et variée qu’elle ne l’a jamais été
dans les forêts d’Europe occidentale (du moins depuis les glaciations), et
peut-être cela prédisposait-il ses premiers occupants Sapiens à reconnaître l’infinie variété des possibles ; mais
cette possible prédisposition, il a fallu nécessairement qu’à un certain
chaînon de la chaîne trajective, elle devienne un dispositif, un habitus conduisant
la pensée elle-même à évoluer dans un certain sens. Quand, comment et pourquoi,
nous ne le saurons jamais, parce qu’il n’en reste pas trace. Alors, tout ce que
nous pouvons faire, c’est interpréter à notre tour, i.e. surprédiquer
l’héritage que nous avons de cette chaîne trajective.
À titre purement hypothétique[26],
donc, je verrais l’un des premiers indices de cette disposition à la pensée complexe dès le IIe millénaire
avant notre ère, dans les hymnes védiques, lesquels en effet révèlent une
conscience de la langue dont les principes sont étrangers au logos. La petite
introduction au sanskrit de Filliozat rapporte par exemple la strophe suivante
(Ṛgveda VIII, 11) :
« Les dieux ont engendré la déesse Parole (vācam). Les créatures de toutes formes
la parlent. Puisse cette Parole, aimable, vache nous donnant son lait de force
et de sève, bien louée, venir près de nous » [27].
Ladite
« parole » (vāc) est
rituelle. Sa valeur religieuse met en ordre le monde, elle cosmise
l’environnement. Le mot vāc vient
d’une racine indo-européenne, WEK,
indiquant l’émission de la voix, qui a par ailleurs engendré notamment le grec epos et le latin vox ; d’où le français épique,
épopée, voix, vocable, avocat, aveu,
révoquer, etc. Réalités humaines
s’il en fut… Or que nous dit l’hymne en question ? Que cette parole,
toutes les créatures la parlent ! Que toutes, en somme, sont des zôa logon echonta – des animaux
possédant la parole, si une telle chose pouvait se penser en grec, hormis dans
les fables…
Cette lointaine prémonition de ce
que la biosémiotique mettra en lumière à la fin du XXe siècle, à
savoir que la transmission de sens est coextensive à la vie, ne fait pas que
rapprocher l’humain des autres vivants (ce qui, à n’en pas douter, entretiendra
quelque rapport avec l’idée de transmigration) ; c’est aussi, plus
particulièrement, refuser d’abstraire la parole du reste des phénomènes.
Empêcher donc le logos de s’en aller tout seul, et parier plutôt sur la
concrescence, l’aller-avec des mots et des choses… La même disposition
s’affirme dans la poétique japonaise, qui entend ne pas séparer le waka和歌 (« poésie
japonaise ») des autres manifestations de la vie, comme en témoigne la
fameuse introduction de Ki no Tsurayuki au Recueil
de poèmes anciens et modernes (Kokin
waka-shû, compilé vers 905) : « À écouter la fauvette qui chante
parmi les fleurs ou la grenouille qui gîte dans les eaux, on voit qu’il n’est
pas d’être vivant qui ne chante son chant /ne compose de poème (iki toshite ikeru mono izure ka uta wo
yomazarikeru) »[28].
D’une foulée téméraire, je
rapprocherai donc ladite strophe de l’une des stances les plus fameuses du Traité du Milieu (II, 8) de Nāgārjuna,
texte fondateur du bouddhisme du Grand Véhicule. Dans la traduction de Guy
Bugault[29],
celle-ci s’énonce :
« Tout d’abord, celui qui marche ne marche pas,
pas davantage celui qui ne marche pas ».
Que « celui qui marche ne
marche pas », gantā na gacchati[30], voilà qui
répugne au logos. À juste titre, du moins dans la dimension régalienne que
celui-ci s’est arrogée. Or qu’en est-il si vous considérez l’ensemble complexe
mais unitaire du phénomène de la marche ? Autrement dit, la réalité ?
Pouvez-vous y distinguer – y discrétiser – l’agent de mouvement du mouvement
lui-même ? Non. L’absurdité apparente de ce paradoxe, « celui qui
marche ne marche pas », ne se définit qu’à partir du moment où, de cette
concrescence qu’est le phénomène de la marche, la langue abstrait d’une part un
sujet (le marcheur), de l’autre un verbe (marcher) ; puis la logique, à
son image, un sujet d’une part (le marcheur), de l’autre un prédicat
(marcher) ; soit, se donnant libre cours, les structures mères du logos
européen, S-V-C[31] et S-P. C’est justement
cette « fiction logico-grammaticale » (l’expression est de Bugault,
p. 55) que Nāgārjuna entend défaire. Or comment ne pas voir que son intention
s’apparente au parti susdit : refuser d’abstraire la parole du reste des
phénomènes, et reconnaître la complexité unitaire de la réalité ?
Dire que le logos discrétise
(décompose analytiquement) la concrescence de la réalité, c’est dire du même
pas qu’il dénoue l’aller-avec des mots et des choses, autrement dit qu’il
désymbolise[32], dépoétise, dévitalise. Au
fil de l’histoire, cette tendance finira par engendrer le dualisme mécaniciste
moderne, pensée non forestière s’il en fut, c’est-à-dire étrangère à la vie. Ne
nous étonnons pas que, vue du Japon, cette pensée puisse être qualifiée de
« désertique »…
[1]
Jacques TASSIN, À quoi pensent les
plantes ?, Paris, Odile Jacob, 2016.
[2] Jakob
von UEXKÜLL, Milieu animal et milieu
humain, trad. par Charles Martin-Freville, Paris, Rivages, 2010 (Streifzüge
durch die Umwelten von Tieren und Menschen, 1934) ; WATSUJI Tetsurô, Fûdo,
le milieu humain, trad. par Augustin Berque, Paris, CNRS, 2011 (Fûdo. Ningengakuteki kôsatsu,
1935) ; Augustin BERQUE, Écoumène.
Introduction à l’étude des milieux humains, Paris, Belin, 2008
(2000) ; Id., La Mésologie, pourquoi et pour quoi
faire ?, Nanterre La Défense, Presses universitaires de Paris Ouest,
2014.
[3]
Werner HEISENBERG, La nature dans la
physique contemporaine (Das Naturbild der heutigen Physik, 1955), Paris, Gallimard, 1962, p. 33-34.
[4] André
LEROI-GOURHAN, Le Geste et la parole,
Paris, Albin Michel, 1964, 2 vol.
[5] Je
reprends ci-après quelques passages de mon livre Le Sauvage et l’artifice. Les Japonais devant la nature, Paris,
Gallimard, 1997 (1986), p. 94 sqq.
[6] Sous occupation russe
depuis 1945.
[7]
UEYAMA Shunpei et al., Shôyô jurin bunka, Tokyo, Chûô kôron
sha, vol. I, 1969, vol. II, 1976.
[8] Dans
cet article, les noms japonais sont donnés dans l’ordre normal en Asie
orientale, patronyme en premier.
[9]
Tokyo, Fuzanbô, 1907.
[10] Op. cit., p. 91
[11] Les
mêmes caractères peuvent aussi se lire ebi
iro, couleur moins foncée que le budô
iro.
[12]
Composé de miso (soja fermenté), œuf,
pâte de riz sucré ; de couleur jaune avec un parement de couleur chocolat.
[13] Les ryokan 旅館,
hôtels à la japonaise, que la langue distingue des hôtels à l’occidentale, hoteru ホテル.
[14] Pour
plus de détails, v. Le Sauvage et
l’artifice, op. cit.
[15] Sur
ce thème, v. mon Histoire de l’habitat
idéal. De l’Orient vers l’Occident, Paris, Le Félin, 2010, 2016.
[16] Je
dois l’idée de « monde prédicatif » (jutsugo sekai 述語世界)
à la « logique du prédicat (jutsugo
no ronri 述語の論理) »
– dite aussi « logique du lieu (basho no ronri 場所の論理) » de Nishida Kitarô
(1870-1945). Sur ce thème, v. Augustin BERQUE (dir.) Logique du lieu et dépassement de la modernité, Bruxelles, Ousia,
2000, 2 vol. ; et plus particulièrement du point de vue mésologique, mon Écoumène, op. cit.. Dans la formule r = S/P, S est le donné environnemental,
P un certain monde (la manière de saisir S), et S/P (S en tant que P) la
réalité du milieu.
[17]
Barthes lui-même adoptait un autre mode de représentation, mais qui revient
strictement au même. J’adopte volontairement la même formulation que pour mes
chaînes trajectives, lesquelles, en retour, pourraient aussi être représentées
à la façon barthésienne.
[18] J’ai
montré par exemple, dans Histoire de
l’habitat idéal, op. cit., comment ce qui à l’origine n’était qu’un mythe –
celui de l’Âge d’or en Europe, celui de la Grande Identité (Datong 大同)
en Chine – est devenu, en trois mille ans d’histoire, d’abord paysage, puis
jardin paysager, puis pavillon suburbain, puis étalement urbain, pour aboutir,
avec l’urbain diffus, à jouer un rôle substantiel dans le réchauffement de la
planète Terre.
[19] En
particulier des religions, comme le début de l’évangile selon saint Jean
l’exprime superbement : Au commencement était le Verbe (i.e. P), et le
Verbe était auprès de Dieu (pros ton
Theon, ce qu’on peut aussi bien comprendre comme « au sujet de
Dieu »), et le Verbe (P) était Dieu (S, la substance absolue).
[20]
Hypostase au sens éventuellement le plus matériel. Pour la mésologie, c’est là
en effet comment fonctionnent – i.e. trajectivement – non seulement l’histoire,
mais l’évolution, comme j’ai essayé de le montrer dans Poétique de la Terre. Histoire naturelle et histoire humaine, essai de
mésologie, Paris, Belin, 2014. V. également la postface (« La
mésologie d’Imanishi ») de ma traduction d’IMANISHI Kinji, La Liberté dans l’évolution. Le vivant comme
sujet, Marseille, Wildproject, 2015 (Shutaisei
no shinkaron, 1980).
[21] Op. cit., p. 35 de la traduction.
[22]
Tokyo, Nippon Hôsô Shuppan Kyôkai, 1978.
[23] J’appelle ainsi le
constructivisme absolu qui aboutit à fermer sur eux-mêmes les systèmes de
signes, sans plus de lien avec la nature, à la façon de Derrida et plus
largement de la French theory.
[24] Sur
ce thème, v. Bernard d’ESPAGNAT, Traité
de physique et de philosophie, Paris, Fayard, 2002, p. 128.
[25] Sur
ce thème, v. YAMAUCHI Tokuryû, Rogosu to
renma (Logos et lemme), Tokyo, Iwanami, 1974. Trad. française par A. Berque
à paraître aux éditions du CNRS.
[26] Je
reprends ci-après un passage de mon Poétique
de la Terre, op. cit., chap. VII,
« Admettre le tiers ».
[27]
Pierre-Sylvain FILLIOZAT, Le sanskrit,
Paris, PUF, 2010 (1992), p. 17.
[28] Traduction
Jacqueline PIGEOT, Questions de poétique
japonaise, Paris, PUF, 1997, p. 9. Le ka
歌 de waka 和歌 se lit également uta et signifie à la fois « chant » ou
« poème ».
[29]
NĀGĀRJUNA, Stances du milieu par
excellence. Traduit de l’original sanskrit, présenté et annoté par Guy Bugault,
Paris, Gallimard, 2002, p. 61.
[30] Pour
le texte sanskrit, je me réfère à l’édition quintilingue (sanskrit, tibétain,
chinois, japonais, allemand) de Teramoto, Chûron
中論 (Traité
du milieu), Tokyo, 1977 (1937), p. 40, qui écrit ici ganatā au lieu de gantā ;
mais on cite plus couramment la forme
gantā. Le mot est de même racine que l’allemand gehen ou l’anglais go ;
d’où les traductions habituelles der
Geher geht nicht, et a goer does not
go.
[31] Il
n’y a certes pas ici de complément (C), mais cela n’affecte pas la structure,
qui est prête à en recevoir.
[32] Ce
qui, en l’occurrence, donne au logos un je-ne-sais-quoi de dia-bolique… Mais ne renions quand même pas ce qui a fait la
modernité ! D’autant que ce sont les deux reines de la science moderne, la
physique et la biologie elles-mêmes, qui permettent aujourd’hui de fonder dans
la nature la trajectivité et les chaînes trajectives. Quant à l’Asie, le
taoïsme, tout autant que le bouddhisme, a préféré au dualisme la
« com-préhension » ; témoin ce passage du Zhuangzi (Qiwulun, II,
1) : « Le grand savoir embrasse, le petit savoir sépare » (da zhi xianxian, xiao zhi jianjian 大知閑閑、小知閒閒).